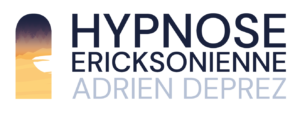Dans une ruelle en travaux, un vieil homme s’arrête devant un mur fraîchement abattu. À travers l’ouverture, il découvre une cour qu’il avait oubliée, un espace familier mais recouvert de lierre et de silence. Il murmure : « Je ne savais plus que c’était là. » L’ouvrier, sans lever les yeux, répond : « Ce n’est pas que ça n’existait plus, c’est juste que ça ne servait plus à rien. »
Ce que l’on croit avoir laissé derrière soi continue souvent à parler, à travers les interstices du présent. Des gestes, des choix, des peurs s’installent sans explication claire, comme si une main invisible dictait certains mouvements. Le passé, loin d’être un décor figé, infiltre les dialogues, les émotions, les verdicts intérieurs. Il ne s’agit pas d’un souvenir rangé sur une étagère, mais d’un manuscrit en cours de réécriture, dont certaines pages s’imposent en silence.
Alors se pose une question apparemment naïve : qu’est-ce qui, dans le passé, nous regarde encore sans que nous en ayons conscience ? Derrière cette question se cache une autre, plus dérangeante : à quel point ce que l’on croit être soi n’est-il qu’une suite de répétitions bien habillées ?

Quand le passé fissure le présent, le silence parle encore. (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Quand le présent parle avec des mots d’hier
Le temps n’est pas un linéaire tranquille. Il se plie, se replie, s’infiltre. Ce que l’on croit derrière soi se tient encore là, dans l’ombre portée d’un geste, dans l’accent d’un mot, dans la tension inexpliquée d’un regard. Le passé ne dort jamais. Il ne se contente pas d’être un souvenir que l’on convoquerait par choix ou nostalgie. Il s’installe dans les silences, colore les pensées, murmure dans les décisions. Ce qui semble terminé revient souvent, mais autrement, glissé sous d’autres masques, parfois plus séduisants, parfois plus inquiétants.
Chaque individu hérite d’un réseau de signifiants, comme une langue qu’il n’a pas choisie mais qui parle en lui. Ces mots, ces images, ces sensations premières, sont les briques invisibles de sa perception du monde. Ils forment une matière vivante, mouvante, qui filtre le réel. Ce filtre, nous l’appelons souvent « moi », alors qu’il n’est qu’un compromis fragile entre ce qui a été et ce que l’on voudrait être.
Les traces qui traversent le présent
On croit souvent que ce qui est derrière est terminé. Mais les expériences passées ne ferment jamais totalement leur porte. Au contraire, elles s’actualisent en permanence, discrètement, dans les inflexions du quotidien. Un mot entendu dans l’enfance peut résonner dans une dispute conjugale, trente ans plus tard, sans qu’on sache pourquoi il déclenche une telle rage ou une telle peur. Le corps se souvient souvent avant que la pensée n’y parvienne.
La mémoire n’est pas une archive rationnelle. Elle est une fiction en mouvement, un récit qui se recompose selon les besoins du présent. Ce que l’on se raconte sur soi-même n’est pas l’exact reflet des faits, mais une mise en scène plus ou moins cohérente, destinée non à refléter la vérité mais à survivre à celle-ci. Le passé s’écrit au passé, mais il se vit au présent.
Le labyrinthe du récit de soi
Dans l’intimité d’un cabinet, les histoires se disent. Des souvenirs, des faits, des scènes censées expliquer ce que l’on est devenu. Mais plus le récit avance, plus les certitudes vacillent. Ce n’est pas tant ce qui s’est passé qui compte, que la façon dont cela se raconte. Le récit de soi est une construction, souvent fidèle à une logique affective plus qu’à une chronologie. Il y a des trous, des répétitions, des anachronismes. Et surtout, il y a ces moments où quelque chose résiste au langage – une émotion, une image, un silence – comme si le réel du passé échappait à toute narration.
Pourtant, c’est dans cette construction, aussi instable soit-elle, que l’on peut commencer à discerner les motifs cachés. Les motifs de la répétition. Car ce qui n’est pas compris tend à revenir. Sous une autre forme, dans un autre lien, avec une autre violence. Comprendre l’influence du passé, ce n’est pas regarder en arrière pour se lamenter. C’est apprendre à voir les pièges qui se rejouent, les reflets distordus d’une scène ancienne qui rejouent leur énigme dans une situation actuelle.
Mémoire et mensonge, vérité et fiction
Le langage lui-même est complice de ce théâtre. Il permet de dire la vérité tout en la dissimulant. Il autorise le mensonge sincère, l’aveu déguisé, la vérité masquée de manière à rester vivable. Ainsi, un patient peut dire la vérité en surface, tout en gardant intacts les ressorts inconscients de ses actes. C’est là que l’écoute attentive, celle qui ne croit pas au premier mot venu, devient un art. Entendre ce que l’autre ne sait pas qu’il dit. Lire entre les lignes du récit de soi ce que le passé a encore à dire.
C’est pourquoi certaines approches thérapeutiques jouent avec le langage, le retournent, le provoquent. Non pour humilier ou confronter gratuitement, mais pour faire émerger l’absurde des certitudes, déstabiliser les fictions trop bien ficelées. Le sens ne se donne pas, il se découpe dans l’inconfort, dans le déplacement, dans une parole qui trébuche. C’est souvent dans ces faux pas que surgit un éclat de réel.
Quand la parole ouvre un chemin
Il arrive qu’un mot, au détour d’une séance, fasse trembler toute la structure. Comme un grain de sable dans une mécanique trop huilée. Alors le sujet s’arrête, hésite, s’étonne de ce qu’il vient de dire. C’est dans ces moments-là que le passé se manifeste autrement : non plus comme une chaîne, mais comme une clef. Une ouverture. Une possibilité nouvelle.
L’hypnose, dans son approche la plus fine, travaille précisément à ce niveau. Elle ne cherche pas à faire disparaître les traces du passé. Elle les invite à parler autrement. À se raconter sous d’autres formes, à travers d’autres images, d’autres sensations. Elle crée un espace où le sujet peut revisiter ses mémoires sans s’y enliser. Non pour les effacer, mais pour les réécrire autrement. Le réel ne change pas, mais sa carte, elle, peut se redessiner.
Le changement, alors, n’est pas une rupture violente ni un reniement de ce qui a été. C’est une transmutation. Ce qui pesait devient ressource. Ce qui enfermait devient passage. Ce qui faisait douleur devient message.
À l’ombre des gares intérieures
Parfois, un homme passe devant une vieille gare désaffectée. Il s’arrête. Le bâtiment est délabré, les vitres brisées, les rails envahis par les herbes. Rien ne bouge, et pourtant il sent quelque chose. Comme un appel. Il croyait avoir oublié cet endroit. Mais en s’approchant, il entend un bruit. Quelque chose remue dans l’ancien guichet. Un souvenir ? Une peur ? Une version de lui laissée là, il y a longtemps ? Il ne sait pas. Mais il tend l’oreille. C’est le début d’un autre voyage.
L’hypnose propose parfois ce type de retour. Pas pour habiter les ruines, mais pour écouter ce qui y vibre encore. Pour rendre au passé ce qui lui revient, et reprendre ce qui peut encore servir. Le vrai changement n’est pas un oubli. C’est un dialogue, discret, entre le maintenant et l’autrefois.
Et si le passé ne dort jamais, peut-être suffit-il d’apprendre à l’écouter autrement.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI