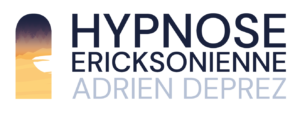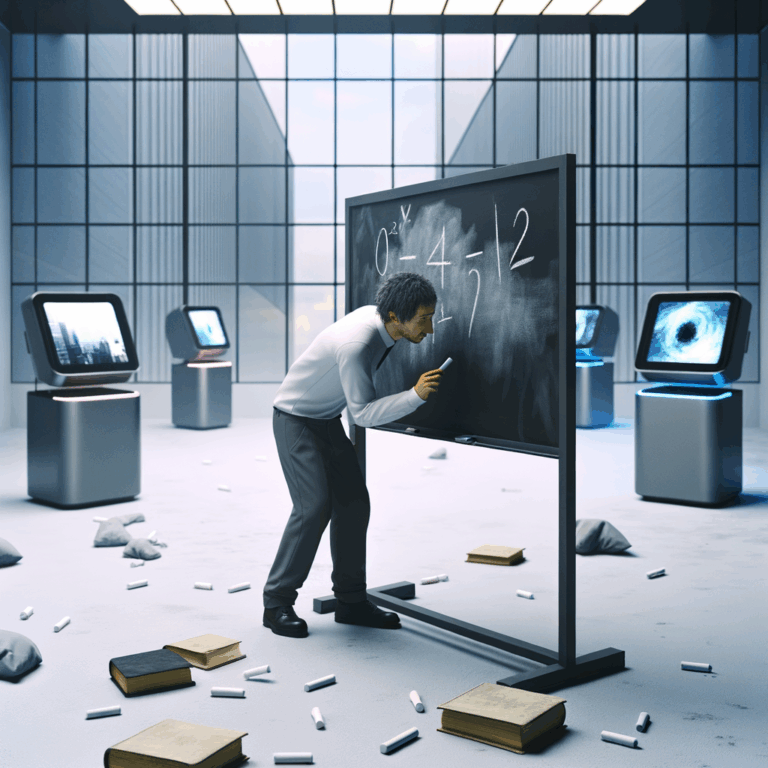À la sortie d’un bâtiment administratif aux allures strictes, une femme s’arrête sur le trottoir. Elle tient un dossier sous le bras, son regard perdu vers l’horizon. Autour d’elle, les panneaux dictent les directions : « sens interdit », « voie réservée », « accès réglementé ». Elle murmure : « Je ne sais plus si je vais ou si je reviens. » Les mots sur les murs, comme ceux dans sa tête, tracent des lignes fermées qu’elle ne sait plus franchir. Ce n’est pas le lieu qui l’enferme, mais ce qu’on y dit, ce qu’on y pense, ce qu’on y répète.
La langue parle toujours avant celui qui croit parler. Elle impose ses formes, ses oppositions, ses évidences. Elle dicte ce qu’il est convenable de ressentir, de penser, de vouloir. Et parfois, c’est dans cette docilité apparente que l’étrangeté surgit : une phrase de trop, un mot de travers, un silence insolent. Comment retrouver une pensée libre, quand les mots à disposition portent déjà en eux leur propre clôture ?

Perdue entre les mots et les murs invisibles (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Les murs invisibles des mots
Il y a, dans chaque parole prononcée, un pacte silencieux. Une forme d’accord tacite avec le monde tel qu’il est déjà structuré. Le langage n’est pas neutre. Il façonne notre rapport à la réalité comme un architecte souterrain, dessinant des murs sans que nous en percevions toujours les fondations. Chaque mot est une balise. Une frontière mentale. Dire je suis en colère n’est pas la même chose que hurler, trembler ou se taire. Le mot canalise, mais aussi rétrécit. Il encadre l’expérience, parfois jusqu’à l’étouffer.
Dans cette architecture verbale, ce sont les contours plus que le contenu qui altèrent la pensée. Car les mots que nous utilisons, souvent appris sans conscience, tracent des limites à ce que nous pouvons concevoir. Ils imposent des catégories fixes. Ils nous forcent à dire ce qui est dicible. Et ce qui ne l’est pas… s’évapore dans le silence ou la confusion.
Quand l’habitude pense à notre place
Le langage quotidien est une arène. Un théâtre où se rejouent sans cesse les scènes convenues de sens et de vérité. Parler, c’est souvent répéter. C’est reconduire un ordre, consolider une vision partagée du monde sans se demander si elle tient encore debout. On dit ce qu’il faut dire, comme il faut le dire. Or, ce confort sémantique agit comme un couvercle. Il évite le vertige de penser autrement. Il calme, mais il endort.
Il existe des moments, pourtant, où le langage se fissure. Des lapsus, des silences, des mots nouveaux qui surgissent, inadaptés, presque absurdes. Là, dans cette brèche, quelque chose cherche à naître. Une pensée encore informe. Un ressenti sans nom. Et si, au lieu de refermer cette ouverture avec les outils du langage connu, on s’y glissait ?
Désapprendre les évidences
Toute nouveauté intérieure implique une rupture avec ce qui structure notre manière de dire. Penser autrement demande de parler autrement. Ou, parfois, de ne plus parler du tout. De s’arracher aux catégories imposées pour qu’apparaisse une autre façon d’exister. Ce processus est douloureux. Déstabilisant. Mais il est aussi profondément libérateur.
Dans le cabinet, face à l’angoisse, à la honte, à la répétition, certains mots tombent comme des chaînes. Je suis nul, je ne vaux rien, je dois être fort. Ces phrases ne décrivent pas la réalité. Elles la créent. Et elles la figent. Chaque discours est une prison possible. Mais aussi une clé. Encore faut-il apprendre à tordre la serrure.
L’invention comme acte de survie
C’est ici que surgit l’importance de la poésie, du jeu, des détournements. Une phrase bancale, un mot-valise, un mélange de langues : tout ce qui fait rupture dans le tissu lisse du discours peut devenir passage vers un autre rapport à soi. L’invention lexicale n’est pas un luxe. C’est parfois une nécessité pour survivre à la logique dominante.
Le langage thérapeutique, lorsqu’il cesse d’être normatif, devient un terrain de jeu. Un lieu d’expérimentation. On y cherche des plis, des torsions, des échappées. Et parfois, dans un mot mal prononcé, dans un rire inattendu, une vérité plus vive que toutes les certitudes se glisse, fugitive mais décisive.
Déconstruire pour mieux construire
Devenir conscient des effets limitants du langage, ce n’est pas le rejeter. C’est en faire un outil plus souple. Un matériau malléable. Cela demande de l’attention. De l’écoute. De la patience aussi. Car les automatismes sont tenaces. Mais reconnaître que nos mots ne sont pas neutres, qu’ils nous parlent autant qu’on les utilise, c’est déjà ouvrir un espace.
Dans cet espace, la pensée peut s’épanouir autrement. Elle peut se risquer à dire ce qui n’a pas encore été dit. Ou même à ne pas le dire. Le silence, parfois, est l’ultime forme du langage quand il devient trop chargé d’attentes sociales, de normes implicites, de rôles figés. C’est là, aussi, que l’hypnose trouve sa place : dans cet entre-deux du mot et du non-dit, où quelque chose peut se réécrire autrement.
Le passage étroit vers l’inconnu
Un homme entre dans un cabinet, le visage fermé. Il dit qu’il va bien, que tout va bien. Mais ses yeux, eux, racontent autre chose. Le praticien ne relève pas. Il ne confronte pas. Il détourne. Il fait une remarque absurde, presque déplacée. L’homme rit. Une faille s’ouvre. Le langage habituel s’effondre. Dans cette brèche naît un autre récit. Moins cohérent peut-être, mais plus vivant.
C’est dans ces instants-là que le changement advient. Quand l’esprit, libéré du carcan des mots attendus, trouve une nouvelle voie. Une voix aussi. Celle qui ne se contente plus de dire le monde tel qu’il est, mais qui ose l’imaginer autrement. Non pas dans la fantaisie, mais dans une fidélité plus profonde à ce qui cherche à émerger.
L’hypnose n’enseigne pas des vérités. Elle ouvre des chemins. Elle défait doucement les coutures du discours figé, pour que l’inconnu puisse faire irruption. Et là, dans le trouble, dans l’étrange, une autre forme de clarté s’installe. Celle qui ne repose plus sur la répétition, mais sur la surprise.
Le reflet trouble d’une eau profonde
Une femme regarde son reflet dans une vitrine, un soir de pluie. Elle ne se reconnaît pas. Ses traits sont brouillés par les gouttes qui ruissellent sur la surface. Et pourtant, c’est là, précisément, dans cette image imparfaite, que quelque chose résonne. Quelque chose qu’elle n’avait jamais vu. Une sensation fugace. Une possibilité. Peut-être n’est-elle pas celle qu’elle croit être. Peut-être même est-elle autre à chaque instant. Le langage, s’il sait se taire au bon moment, peut lui permettre d’habiter cette étrangeté.
Car ce n’est pas dans les définitions que l’on se trouve. Mais dans les mouvements. Dans les glissements. Dans les silences entre les mots. Là où une pensée neuve — encore sans nom — peut naître.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI