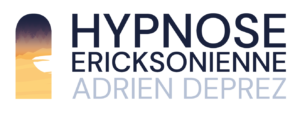Il reste debout, figé devant le distributeur de billets, le bras suspendu entre deux choix — 20 ou 50 euros. Autour, une file s’étire, impatiente. Lui, il ne voit plus qu’un chiffre, une tension dans le ventre, une voix intérieure qui répète : « Prends 50, comme d’habitude. » Mais d’où vient cette habitude ? De l’assurance d’un besoin, d’un souvenir d’enfance, d’un père économe ou d’un manque jamais nommé ? Peut-on vraiment dire qu’il choisit ?
Ce moment banal le trahit. Ce qu’il croit décider semble déjà inscrit dans un réseau invisible : langage, mémoire, culture, peur. Il croit vouloir, mais son vouloir s’est formé ailleurs, longtemps avant lui. L’idée même de liberté paraît alors un théâtre bien orchestré, où les désirs prennent place sans qu’on sache vraiment qui les a écrits. Et si ce n’était pas la liberté qui guide, mais l’illusion d’avoir choisi ?

Un geste simple, chargé de choix déjà écrits (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Quand la liberté devient murmure
Un homme entre dans un café, choisit une table près de la fenêtre, commande un espresso sans sucre, comme toujours. Il pense avoir choisi librement. Pourtant, qu’est-ce qui l’a conduit ici, à cette table, à cette habitude ? Une préférence ? Une conviction ? Ou bien un enchaînement discret de micro-influences, de souvenirs d’enfance, de modèles intériorisés ? Le libre arbitre, tel un mirage, semble à portée de main, mais dès qu’on l’approche, il se dissipe dans la brume des déterminismes invisibles.
L’envers du choix : une architecture invisible
Chaque décision que l’on croit prendre résulte d’un tissage antérieur. Dans les coulisses de la conscience, des structures silencieuses orchestrent le théâtre de nos volontés. Le langage, par exemple, ne sert pas seulement à dire ; il nous dit autant qu’il nous permet de parler. Nos mots nous précèdent. Nos pensées s’y débattent. Et avant même que le choix apparaisse dans notre esprit, il est déjà encadré, balisé, autorisé par ce que notre culture accepte de concevoir.
Le sentiment de choisir librement ne serait-il alors qu’un effet secondaire ? Un artefact cognitif produit par un appareil psychique qui rationalise l’inévitable ? Ce que l’on croit décider aujourd’hui trouve souvent ses racines dans des scénarios écrits bien plus tôt, dans l’enfance, dans la structure familiale, dans le regard d’un professeur, dans une phrase dite à la volée et jamais oubliée. Les rails sont posés longtemps avant que le train ne démarre.
Le corps comme messager de l’inconscient
Une femme hésite à changer de travail. Elle dresse des listes, pèse les pour et les contre, consulte son entourage. Mais chaque fois qu’elle s’approche d’une décision, un malaise diffus la retient. Elle parle de peur, de doute, mais le corps dit autre chose : migraines, insomnies, palpitations. Là où le conscient argumente, l’inconscient s’exprime autrement. Et ses messages, bien qu’énigmatiques, sont souvent plus fiables que les discours rationnels.
L’inconscient agit sans bruit. Il n’exige pas, il oriente. Il murmure à travers les gestes, les lapsus, les répétitions. Ce que nous appelons « choix » est souvent une réponse à une tension intérieure dont nous ignorons l’origine. Le libre arbitre vacille, non parce qu’il est inexistant, mais parce qu’il est infiltré, contaminé, traversé de forces muettes qui nous déplacent à notre insu.
Langage et normes : les tuteurs invisibles du désir
Dans une société saturée de langages, la liberté prend souvent la forme de ce que l’on peut dire. On ne désire que ce que l’on sait nommer. Et ce que l’on peut nommer dépend des discours dominants, des récits partagés, des représentations collectives. Ainsi, le désir se forme dans un moule social. Il n’est pas libre, il est socialisé.
Une jeune fille rêve de devenir médecin. Est-ce par vocation ? Peut-être. Mais peut-être aussi parce que ce rêve est autorisé, valorisé, reconnu. D’autres désirs, plus incertains, plus singuliers, restent enfouis car ils n’ont pas de mot, pas de place, pas d’image. En ce sens, notre liberté est balisée. Non par des chaînes, mais par des récits. Pas par la force, mais par le sens.
La responsabilité de l’aveuglement
Déclarer que le libre arbitre est une illusion ne dispense pas de responsabilité. Au contraire. Car à mesure que l’on prend conscience des structures qui nous déterminent, une autre forme de liberté devient possible. Non pas celle de choisir librement, mais celle de comprendre pourquoi l’on choisit. Et dans cette lucidité, quelque chose se déplace.
Le thérapeute, dans son cabinet, ne cherche pas à rendre ses patients libres au sens naïf du terme. Il les aide à repérer ce qui les traverse, à nommer ce qui les gouverne. Là où ils voyaient des choix, il révèle des fidélités inconscientes. Là où ils parlaient de destin, il montre des fantômes. Et parfois, dans ce désordre, une décision nouvelle émerge. Non pas ex nihilo, mais depuis un lieu plus clair, plus conscient.
La mise à nu du conditionnement
Déconstruire ses déterminismes n’est pas un exercice purement intellectuel. C’est un travail de dévoilement, souvent douloureux. Car ce que l’on découvre, ce ne sont pas seulement des habitudes ou des réflexes, mais aussi des attachements. Des loyautés invisibles, envers une mère dépressive, un père exigeant, une idée de soi construite sur du manque.
Ce dépliage progressif permet d’ouvrir une brèche. Une brèche dans le connu, dans le répétitif. Et dans cette faille, quelque chose peut se transformer. Ce n’est pas une liberté absolue qui surgit, mais une autonomie relative, enracinée dans la conscience de ses chaînes. Une autonomie qui choisit, non parce qu’elle est libre, mais parce qu’elle sait d’où elle part.
Vers un art du déplacement intérieur
Un homme décide de quitter sa compagne après vingt ans de vie commune. Ce choix, qu’il croit spontané, a mûri lentement. Il ne l’a pas décidé un matin, mais l’a senti s’installer. Comme une marée qui monte lentement, sans bruit, jusqu’à ce que l’eau atteigne les chevilles. En réalité, ce n’est pas une décision, c’est une reconnaissance. La reconnaissance d’un mouvement intérieur, longtemps nié, devenu irrépressible.
Ainsi va toute décision authentique : elle n’est pas arrachée à l’instant, mais surgit d’un long processus souterrain. L’hypnose, dans ce contexte, ne crée pas le changement. Elle le révèle. Elle permet d’écouter ce qui, en nous, savait déjà. Sous la suggestion apparente, elle propose une exploration. Une mise en suspension du mental pour entendre la rumeur ancienne du désir.
Ce que la liberté devient, quand elle cesse d’être une revendication
Dans une ruelle étroite, une femme marche entre deux murs. Elle avance lentement, ses mains frôlent les pierres. À un moment, le passage s’ouvre. Elle ne l’a pas choisi. Elle ne savait même pas que ce passage existait. Mais elle le prend. Non pas parce qu’elle est libre, mais parce qu’elle est là, présente, attentive. Elle ne cherche plus à être libre. Elle répond à l’appel discret d’un possible.
La liberté n’est plus alors un drapeau, ni un cri. Elle devient une écoute. Une manière de rencontrer ses ombres et d’en faire des guides. Dans ce retournement intérieur, le changement devient non pas un acte de volonté, mais un glissement du regard. Et parfois, c’est dans ce glissement que l’on se découvre capable de vivre autrement.
L’hypnose, en tant qu’expérience, propose de suspendre les repères habituels. Elle ne donne pas de réponses, mais elle rend possible l’émergence de questions oubliées. Elle n’impose rien, elle invite. Et dans cette invitation, chacun peut trouver un sentier entre les murs. Non pour fuir les déterminismes, mais pour apprendre à danser avec eux.
article créé avec la collaboration de Chat GPT d’OpenAI