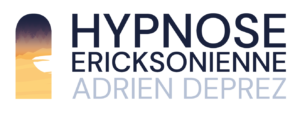Une femme fixe longuement l’écran d’un échographe. À ses côtés, un homme serre les accoudoirs de sa chaise. Sur le moniteur, un amas de formes floues s’anime par à-coups. Deux silhouettes penchées sur l’image cherchent à en extraire un sens. L’un murmure : « On dirait une tête… non ? » L’autre acquiesce sans certitude. Ce n’est qu’au moment où le médecin trace un cercle, pointe une ligne, nomme ce qui semblait informe, que soudain, tous deux voient. Pas simplement une image. Une promesse, un enfant, un futur. Ce passage de l’image au symbole transforme la perception en expérience. La question ne serait donc pas tant « qu’est-ce que je vois ? » mais « qu’est-ce que ça signifie, pour moi, ici, maintenant ? »
Si toute image brute nous traverse sans jamais s’ancrer, c’est son passage au statut de symbole qui l’inscrit dans la mémoire et dans le monde. Mais que faut-il pour qu’une image devienne symbole ? Quels mécanismes culturels, émotionnels et langagiers s’activent dans cet entre-deux silencieux où le regard bascule en reconnaissance ? Peut-être que ce n’est pas la réalité qu’on regarde, mais le miroir de ce qu’on est prêt à voir.

Quand une image devient symbole, elle prend vie en nous. (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Ce que l’image nous cache, nous révèle
Un homme contemple la façade d’un immeuble. Les vitres reflètent le ciel, les passants, des morceaux de ville. Il croit voir un bâtiment. Mais ce qu’il voit, c’est déjà une interprétation. Car à l’instant même où l’image se présente à lui, elle est traversée par un faisceau de références, de souvenirs, d’associations. Il ne regarde pas un immeuble. Il regarde ce qu’il pense être un immeuble. L’image précède la pensée, mais n’y échappe jamais.
L’image ne montre jamais tout. Elle suggère, dissimule, détourne. Elle enveloppe une absence. Derrière ce qui semble offert au regard, se tisse un langage plus ancien que les mots, plus diffus que la pensée. Ce langage, c’est celui du symbole. Une image ne commence à signifier que lorsqu’elle s’inscrit dans une trame invisible, faite de signifiants, de mythes, de codes. Ce qui est visible n’est que la peau du réel. Ce qui fait sens palpite en-dessous, dans l’ombre portée de la vision.
Voir c’est déjà traduire
Chaque regard est une interprétation. Une photographie d’enfant souriant peut évoquer la joie, l’innocence, ou la solitude d’un souvenir perdu, selon celui qui la regarde. L’image brute ne signifie rien tant qu’elle ne s’insère pas dans une trame de sens partagée.
Notre perception visuelle est donc toujours médiatisée. Culture, histoire, langage, inconscient collectif : ces filtres orientent la lecture que nous faisons d’une image. Une même scène peut susciter des lectures contradictoires selon le contexte dans lequel elle est posée. Une main tendue peut être une offrande, une menace ou un adieu. L’image, en elle-même, ne tranche pas. Elle propose. Le reste se joue dans l’interprétation.
Mais pour que l’image devienne un symbole, encore faut-il que le spectateur dispose d’un répertoire. La reconnaissance du symbole suppose l’existence préalable d’un système de signifiants partagés. Sans code, l’image reste opaque. Elle échoue à produire du sens.
Ce que le symbole fabrique en silence
Le symbole n’est pas une décoration de l’image. Il en est la clef. Il relie le visible à ce qui ne l’est pas. Il donne à voir ce que l’image seule ne peut montrer. Une colombe ne dit rien sans la paix. Une croix n’est qu’un angle sans la mémoire du sacrifice. Le symbole est le trait d’union entre la perception et l’idée, entre le corps et l’âme.
Comprendre comment l’image se transforme en symbole, c’est apprendre à lire le monde autrement. C’est voir que le réel n’est jamais nu. Il porte des vêtements de sens, cousus par l’imaginaire collectif. Chaque image que nous croisons dans nos vies – une publicité, un rêve, une peinture, un souvenir – parle un langage que nous connaissons sans le savoir. Un langage qui vient de loin. De notre enfance. De notre culture. De notre peur du vide.
Quand le visible devient stratégie
De nombreux patients arrivent en cabinet avec des images d’eux-mêmes. Ils ne viennent pas seulement avec des mots, mais avec des visions intérieures. Des scènes, des souvenirs figés, des représentations de ce qu’ils croient être ou devoir être. L’image est alors un piège. Elle fige le sens. Elle crée du destin là où il y avait du mouvement.
Dans ces cas-là, l’accompagnement thérapeutique consiste à déplier l’image. À en faire résonner les strates. À entendre ce qu’elle contient de symbolique pour permettre à l’histoire de se raconter autrement. Car derrière « je me sens vide » peut se cacher une image de chambre noire. Derrière « je suis bloqué » se dessine une cage. Ces images sont des portes. Encore faut-il reconnaître la serrure.
On ne soigne pas une image. Mais on peut en révéler la structure. Et, parfois, inviter la personne à en construire une autre. Une image plus souple. Moins tyrannique. Moins définitive.
Quand l’image devient une peau trop étroite
Certains patients vivent selon des images imposées. La réussite, la virilité, la maternité accomplie, l’indépendance brillante : autant de figures qui s’impriment dans l’inconscient collectif et colonisent les subjectivités. L’image devient injonction. Elle ne reflète plus l’être. Elle le contraint.
Ces représentations, souvent nourries par les médias, les héritages familiaux ou les réseaux sociaux, ne sont pas neutres. Elles enferment dans des scénarios de performance ou d’échec. Ce n’est pas que le patient n’est pas heureux. C’est qu’il ne correspond pas à l’image du bonheur qu’on lui a enseignée.
Là encore, le travail thérapeutique peut consister à remettre en mouvement ce qui a été figé. À interroger : qui t’a dit que c’était cela, réussir ? D’où vient cette image ? Que veut-elle montrer ? Que cache-t-elle ? On ne détruit pas une image. On la rend translucide. On apprend à voir à travers elle.
L’hypnose, ou l’art de traverser l’image
Dans l’hypnose, on travaille souvent avec des images. Mais pas n’importe lesquelles. Ce ne sont pas des images décoratives. Ce sont des seuils. Des passages. Elles supportent un déplacement de sens. Une porte qui se ferme dans la transe peut signifier la fin d’un cycle. Un escalier peut être une ascension vers une part oubliée de soi. Une forêt, l’inconnu à apprivoiser.
L’image hypnotique n’est pas là pour illustrer. Elle est là pour activer. Elle engage le corps, les émotions, la mémoire implicite. Elle est un langage du cerveau ancien, celui qui ne pense pas mais qui ressent. L’image devient alors une expérience. Elle permet d’accéder à des couches de réalité inaccessibles à la simple logique. Elle ouvre l’espace du changement.
Mais il ne suffit pas d’avoir une image. Encore faut-il la traverser. Ne pas s’arrêter à ce qu’elle montre. Écouter ce qu’elle dit en silence. Dans cette écoute, le sujet peut se réécrire. Il peut redevenir auteur de ses symboles. Façonner son monde intérieur avec des figures qui le rendent vivant, au lieu de le figer.
La vérité peut porter un masque
Une femme entre dans une galerie. Sur les murs, des portraits sans visage. Juste des vêtements, des postures, des décors. Elle s’arrête devant l’un d’eux. Ce tableau, pense-t-elle, parle de moi. Mais il n’y a pas de visage. Rien à quoi s’identifier. Juste une silhouette, une absence. C’est peut-être cela, l’effet des images symboliques. Elles nous révèlent en nous omettant.
Ce que nous reconnaissons dans l’image, c’est la place qu’elle laisse au manque. À l’inachevé. À l’inconscient. Une image pleine de sens est une image qui laisse la place à l’interprétation. Qui ne dit pas tout. Qui suggère. Le symbole n’impose rien. Il attire. Il trouble. Il ouvre.
Et dans cet écart entre ce que l’on voit et ce que l’on devine, un espace de transformation s’ouvre. L’hypnose, la thérapie, la parole, le rêve : tous ces chemins traversent des images. Mais aucune ne dit la vérité. Elles disent, peut-être, que la vérité est ailleurs. Ou qu’elle porte un masque. Et que c’est dans ce masque que réside notre liberté.
Marcher dans les images comme dans un rêve
Un homme marche dans une ville qu’il ne connaît pas. Les rues sont désertes. Les vitrines fermées. Seul un néon rouge clignote au fond d’une ruelle. Il s’en approche. Ce n’est qu’un mot, en lettres inversées, vu à travers une vitre. Rien de plus. Mais dans ce mot, il lit autre chose. Un appel. Un souvenir. Une direction. Il comprend alors qu’il ne cherche pas une rue. Il cherche une réponse. Et que cette réponse se dessine à travers les reflets, les symboles, les formes.
Le réel n’est pas ce que l’on voit. C’est ce que l’on traverse. Ce que l’on transforme. Ce que l’on réinterprète. Les images que nous croisons ne sont pas là pour nous dire ce qui est. Elles nous invitent à questionner ce que nous croyons voir.
À ceux qui cherchent à