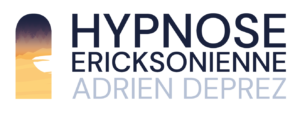Une femme entre dans une administration pour refaire ses papiers. Face au guichet, l’employé examine son dossier et fronce les sourcils : « Votre nom de naissance ne correspond pas aux registres. » Elle insiste, sort d’autres documents, tente de prouver qu’elle est bien celle qu’elle prétend être. Mais rien n’y fait : sans preuve officielle de son identité, elle devient une étrangère sur son propre territoire.
Un nom, un prénom, une désignation suffisent à inscrire un individu dans une réalité partagée. Dès l’enfance, les mots que l’on reçoit orientent ce que l’on pense être. Les parents, la société, les institutions attribuent des signifiants qui forgent une trajectoire, consciente ou non. Pourtant, que reste-t-il lorsque ces repères vacillent ? Peut-on exister sans être nommé ?
Le langage ne se contente pas de décrire, il façonne l’existence. Les catégories sociales et psychiques régissent la perception de soi et des autres. Se réapproprier ce qui nous définit devient alors un enjeu de réinvention. Mais tout ce qui échappe à la nomination semble condamné à l’invisibilité. Comment, dès lors, retrouver une voix lorsque les mots manquent ?

Quand l’identité vacille, peut-on encore exister ? (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Les mots qui sculptent l’existence
Un nom, un prénom, quelques syllabes assemblées qui, dès la naissance, assignent une place. On le reçoit comme un héritage, parfois comme un fardeau, et il devient une étiquette accrochée au corps, une marque invisible qui oriente la perception que les autres auront de nous. Le langage ne se contente pas de nommer, il façonne. Il trace les contours d’une identité, la moule dans un cadre qui semble fixe mais qui, parfois, peut être brisé.
Lorsqu’un enfant entend son nom pour la première fois, il ne sait pas encore qu’il vient d’être jeté dans une histoire qui le dépasse. Ce nom le relie à une lignée, à une mémoire collective, à une langue. Il ne choisit pas ce premier mot qui le définit, mais il devra s’en accommoder, l’habiter ou le rejeter. Certains noms sonnent comme des promesses, d’autres comme des condamnations silencieuses.
Le poids des signifiants
Tout au long de l’enfance, l’identité se construit sous l’influence des signifiants qui lui sont attribués. « Tu es sage », « tu es maladroit », « tu es comme ton père » : autant de phrases qui enferment ou libèrent, qui sculptent une perception de soi avant même que l’enfant ne puisse en comprendre les implications. Ces mots deviennent des vérités subjectives, des cadres invisibles qui orientent la manière dont chacun se perçoit.
Les désignations ne sont jamais neutres. Elles portent en elles l’histoire de ceux qui les prononcent, leurs attentes, leurs craintes. Grandir, c’est souvent apprendre à négocier avec ces étiquettes, à en refuser certaines, à en revendiquer d’autres. Pourtant, ce que l’on ne parvient pas à nommer demeure tapi dans l’ombre, insaisissable.
Nommer pour exister
Ce qui échappe à la nomination se glisse vers l’invisible. Les non-dits, les silences, les choses que l’on tait par peur ou par interdiction restent suspendus quelque part entre le réel et l’oubli. Dans certaines familles, on ne prononce pas certains prénoms, on n’évoque pas certaines histoires comme si, en refusant de les nommer, elles cessaient d’exister. Mais l’inexprimé ne disparaît pas, il s’infiltre dans les non-dits, dans les regards lourds de significations, dans les gestes répétés sans en comprendre la raison.
Lorsqu’un individu ne parvient pas à mettre des mots sur une douleur, une peur, un souvenir, il se retrouve piégé dans un espace flou, indéfini. Nommer une chose, c’est lui donner une existence propre, lui permettre d’être regardée en face. C’est aussi en cela que le langage est un outil de transformation.
Se réapproprier son propre discours
Si le langage peut enfermer, il peut aussi libérer. Se réapproprier les mots qui nous définissent, c’est reprendre possession de soi. Certains changent de prénom pour couper avec une histoire familiale pesante, d’autres utilisent l’écriture, la parole ou l’art pour redéfinir leur place dans le monde. Ce processus de renégociation identitaire passe souvent par la capacité à dire différemment ce qui semblait immuable.
Les thérapies par la parole, les pratiques hypnotiques ou analytiques jouent sur cet enjeu : permettre à chacun de trouver ses propres mots, de redéfinir son récit intérieur. Ce qui était figé peut alors devenir mobile, ce qui semblait une fatalité peut être reconfiguré autrement.
La liberté par la métamorphose du langage
Un homme marche dans une rue qu’il connaît par cœur. Chaque bâtiment, chaque boutique, chaque recoin lui est familier. Il sait où se trouvent les bancs, où poser son regard pour éviter un souvenir douloureux. Un jour, il découvre un passage qu’il n’avait jamais remarqué. Une simple ruelle, qui pourtant change son trajet. En l’empruntant, il se rend compte que la ville qu’il croyait figée est bien plus vaste qu’il ne l’imaginait.
Se réapproprier son langage, c’est comme découvrir cette ruelle cachée. C’est réaliser que l’histoire que l’on se raconte sur soi-même peut être réécrite, que les mots que l’on croyait définitifs peuvent être déplacés, transformés. Lorsque l’hypnose intervient dans ce processus, elle propose de jouer avec ces signifiants, d’explorer de nouvelles voies, d’ouvrir des portes que l’on croyait définitivement closes.
Et si les mots que vous utilisez pour parler de vous-même n’étaient pas les seuls possibles ? Et s’il existait d’autres manières de nommer ce que vous êtes, d’autres façons de tracer les contours de votre existence ? Après tout, ce que l’on ne nomme pas n’existe peut-être pas encore… mais pourrait un jour apparaître.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI