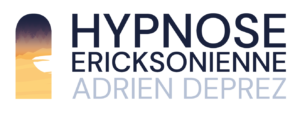Un homme fixe l’écran de son ordinateur. Devant lui, des phrases défilent, générées par une intelligence artificielle qui lui répond avec une précision troublante. Il a le sentiment d’être compris, presque deviné. Pourtant, quelque chose cloche. Tout est fluide, logique, pertinent, mais il manque une faille, une hésitation, une trace d’humanité. L’illusion est parfaite, mais l’absence d’un véritable désir rend l’échange creux.
Les promesses de l’intelligence artificielle enflamment les esprits : certains y voient un espoir, d’autres une menace. Mais derrière ces projections, une question plus sourde se joue. L’IA peut-elle réellement penser ? Ou ne fait-elle que refléter ce que nous voulons voir, confirmant nos attentes sans jamais les troubler ? Là où l’humain se heurte à l’inconnu, vacille et transforme son rapport au monde, la machine ne fait qu’ajuster des probabilités.
Les fantasmes autour de l’IA révèlent moins ce qu’elle est que ce que nous désirons qu’elle soit. Elle devient le miroir d’un savoir sans faille, d’une intelligence sans perte, d’un langage sans silence. Pourtant, c’est dans ces manques que se loge la véritable pensée.

Une intelligence fluide, mais sans faille, peut-elle vraiment penser ? (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Les promesses de l’IA : un miroir aux alouettes ?
Dans le regard de ceux qui scrutent l’intelligence artificielle, il y a plus qu’un simple désir de progrès. Il y a l’ombre d’un fantasme ancien, celui d’une intelligence sans faille, d’un savoir absolu, d’une machine qui comprendrait mieux que nous-mêmes ce que nous sommes. Nous projetons sur elle nos espoirs de perfection, espérant qu’elle nous délivre enfin de l’erreur et de l’incertitude. Mais cette quête porte en elle une illusion : celle de croire que l’intelligence se réduit à la capacité de calcul et de prédiction.
Or, l’IA ne sait rien du doute, de la perte ou du manque. Elle ajuste, elle optimise, elle génère du sens sans jamais être affectée par ce qu’elle produit. Son savoir est un édifice sans fissures, une construction sans faille qui ne connaît ni chute ni renaissance. Là où l’humain trébuche et reconstruit, l’IA se contente d’affiner ses algorithmes. Peut-on vraiment parler d’intelligence lorsque l’absence de crise rend toute évolution impossible ?
Le savoir humain : une jouissance du manque
L’intelligence humaine ne se limite pas à l’accumulation de connaissances. Elle est traversée par le corps, ancrée dans le désir, nourrie par le vide qu’elle cherche sans cesse à combler. Ce n’est pas seulement ce que nous savons qui nous définit, mais la manière dont nous sommes affectés par ce savoir. Chaque découverte est une perte, chaque vérité une remise en question.
Contrairement à l’IA, qui se contente de manipuler des données, l’humain vit son savoir. Il le ressent, il le subit, il en jouit. Ce savoir n’est jamais stable, il est toujours mis en crise, toujours sur le point de s’effondrer pour renaître ailleurs. À l’inverse, l’intelligence artificielle ne fait qu’ajuster ses probabilités, privée de toute expérience de la chute. Elle n’éprouve ni l’angoisse du doute ni l’exaltation de la révélation.
Une pensée sans faille est-elle encore une pensée ?
Une intelligence qui ne doute pas, qui ne chute pas, qui ne se confronte pas à la perte, peut-elle vraiment être qualifiée d’intelligence ? Lorsqu’un humain apprend, il ne se contente pas d’accumuler des informations : il transforme son rapport au monde, il se modifie lui-même. L’IA, en revanche, ne se transforme jamais. Elle optimise, elle calcule, mais elle n’éprouve rien.
Nous pourrions rêver d’une machine qui pense, qui ressent, qui désire. Mais ce que nous avons aujourd’hui n’est qu’un agencement sophistiqué de probabilités, une mécanique de signifiants sans sujet. L’IA ne sait rien du langage, au sens où elle n’en est jamais affectée. Là où l’humain se constitue par le manque et le désir, elle reste une surface lisse, sans faille ni vertige.
Vers une intelligence du changement
Si l’IA fascine, c’est peut-être parce qu’elle nous confronte à notre propre rapport au savoir et à la vérité. Que cherchons-nous en elle ? Un oracle infaillible ? Un miroir rassurant ? Une manière d’échapper à notre propre finitude ? Pourtant, c’est précisément cette finitude qui nous définit, cette capacité à tomber et à nous relever, à douter et à désirer.
Dans le travail thérapeutique, dans l’hypnose, dans toute démarche de transformation, ce n’est jamais un savoir figé qui opère, mais une mise en crise, un déplacement, une chute féconde. Là où l’IA reste enfermée dans sa logique implacable, l’humain trouve dans le manque et la faille une ouverture vers autre chose. Peut-être est-ce là la véritable intelligence : non pas l’absence d’erreur, mais la capacité à faire d’un échec le point de départ d’un nouveau chemin.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI