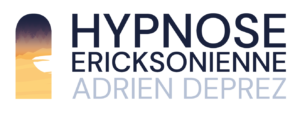Dans un train de banlieue, un homme en costume serre les dents en consultant son téléphone. Ses épaules sont crispées, son souffle court. En face, une femme ferme les yeux, les traits tendus, comme si elle tentait d’échapper à une douleur invisible. L’un et l’autre s’accrochent à une idée : celle que la fatigue sera récompensée, que l’effort d’aujourd’hui prépare un mieux-être à venir. Pourtant, ce soulagement promis s’éloigne à chaque nouvelle contrainte.
Dans un monde où l’effort est glorifié, la confusion s’installe. Travailler, s’entraîner, endurer : tout semble justifié au nom d’un gain futur. Mais cette promesse masque une autre réalité. L’anticipation d’un effort le rend paradoxalement plus supportable, tandis que la souffrance, elle, persiste, insensible aux calculs rationnels. Lutter pour l’effacer ne fait souvent que la fixer davantage.
Le langage, lui aussi, trahit cette illusion. On parle de « se dépasser » quand on s’épuise, de « résilience » quand on endure l’inacceptable. Mais que se passe-t-il si l’on cesse de vouloir l’abolition de la souffrance et qu’on la considère autrement ? Peut-être alors, au lieu de la subir, devient-il possible d’entendre ce qu’elle tente de dire.

Fatigue et résilience : quand l’effort masque la véritable souffrance. (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Quand l’effort devient une illusion
L’effort est érigé en vertu, un socle sur lequel repose l’idéal de progression. Travailler plus, s’entraîner plus, persévérer malgré la douleur. La promesse implicite est qu’à force d’accumulation, l’épuisement débouchera sur une libération. Pourtant, à bien y regarder, ce modèle semble plus proche d’une boucle que d’une issue. Chercher à abolir toute souffrance par l’effort revient à entretenir un mirage : celui d’une délivrance qui se dérobe à mesure qu’on l’approche.
Si l’effort était véritablement le remède à la souffrance, il existerait une fin à la lutte. Or, pour beaucoup, chaque victoire entraîne une nouvelle exigence. Loin d’apporter un soulagement, l’effort devient un mode d’existence, une injonction permanente à faire plus, à mériter son bien-être. Sous couvert d’émancipation, il fabrique des chaînes.
Effort réel et effort imaginé : une confusion persistante
Il est essentiel de distinguer l’effort réel de l’effort projeté. Lorsqu’on anticipe un effort, quelque chose en nous l’amortit. L’esprit contourne l’intensité attendue, simulant une maîtrise qui n’existe peut-être pas. L’effort anticipé est tronqué par l’inhibition de la motilité : il nous semble moins lourd que ce qu’il sera en réalité.
C’est ainsi que l’on s’engage dans des projets, persuadé que l’énergie demandée sera moindre que ce qu’elle sera effectivement. Une fois plongé dans l’action, la résistance du réel se rappelle à nous. Ce décalage alimente la frustration : nous avons cru que notre effort suffirait à éviter la douleur, et nous découvrons qu’il ne fait que la déplacer.
Un engrenage capitaliste : l’effort pour la récompense
Dans nos sociétés, l’effort n’est pas simplement encouragé, il est structuré comme un moteur économique. Chaque effort est une mise, chaque récompense une promesse. Mais cette récompense ne marque jamais la fin du processus. Elle n’est qu’une invitation à redoubler d’effort pour un gain ultérieur.
Cette dynamique produit un mouvement perpétuel où la satisfaction est retardée, toujours conditionnée à un nouveau palier à atteindre. Cela explique l’épuisement généralisé auquel tant de personnes font face : on croyait atteindre un point de repos, et l’on découvre un nouveau sommet à gravir.
Quand les mots trahissent leur sens
Le langage est un piège subtil. Dans une société où l’on confond effort et souffrance, il devient difficile de voir ce qui nous affecte réellement. L’effort est volontiers présenté comme un vecteur d’accomplissement, quand bien souvent il est un instrument de contrainte.
On impose l’effort aux individus sous couvert de mérite : « Si tu souffres, c’est que tu ne t’es pas assez donné. » Ce discours masque une réalité simple : la souffrance ne disparaît jamais complètement. Elle n’est ni le signe d’un échec, ni d’un manque d’effort. C’est un élément inhérent à l’expérience humaine.
Faire avec la souffrance plutôt que la fuir
Plutôt que de chercher à éradiquer la souffrance par l’effort, il serait peut-être temps d’apprendre à faire avec. La douleur n’est pas un problème à résoudre, mais un signal à écouter. Elle indique des limites, des besoins non respectés, des directions à repenser.
Là où l’effort acharné cherche à nier la souffrance en la repoussant toujours plus loin, une autre approche est possible. Écouter ce que la douleur a à dire, comprendre ce qu’elle signale sans immédiatement vouloir la supprimer. Cette démarche n’est pas passive, elle repose sur un changement de regard : ne plus voir la souffrance comme un obstacle, mais comme une information précieuse.
Le signal du corps
Le corps ne ment pas. Chaque tension, chaque fatigue, chaque douleur est une expression de quelque chose d’enfoui. L’ignorer sous prétexte d’effort ne l’effacera pas.
Accepter la souffrance ne signifie pas s’y résigner. C’est reconnaître qu’elle a un rôle, qu’elle sert de guide. Plutôt que de chercher à la neutraliser par des efforts incessants, il s’agit de l’écouter, de l’apprivoiser, pour qu’elle ne se transforme pas en une prison invisible.
Dans cette perspective, l’hypnose et d’autres formes de thérapie ouvrent des portes insoupçonnées. Elles permettent d’explorer ce qui se joue au-delà des automatismes, de dénouer les mécanismes qui nous enferment dans la lutte. Peut-être qu’alors, au lieu de s’épuiser à poursuivre une libération illusoire, il devient possible de trouver une forme d’apaisement, ici et maintenant.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI